La plainte, ça me parle. Et voilà, le bus est bondé, je suis encore coincée en escalope entre 2 autres passagers. Évidemment, je n’ai pas eu cette augmentation et il pleut encore…Ça n’arrive qu’à moi ce genre de tuile. Comme tout le monde, il m’arrive d’être ce collègue ou cet ami qui râle en continu et pour un rien. Je vois bien combien ça exaspère mon entourage. Ils finissent par ne plus m’écouter ou même carrément me fuir ou m’ignorer. Alors je serre les dents, je ravale mon agacement et je colle un sourire par-dessus. Et là, je sens que c’est moi qui suis exaspérée du manque d’espace pour ventiler. La boule gonfle et généralement, je me sens encore plus mal.
Et là ça me chicotte : si je râle, je dérange les autres. Et si je ne laisse pas sortir ce qui m’agace, je fais la cocotte-minute et c’est moi-même que je dérange. Comment trouver le juste équilibre ?
Trois types de plaintes selon Saverio Tomasella
Tout le monde se plaint. D’après certaines études, nous y passons tous une dizaine de minutes par jour. Saverio Tomasella est docteur en psychologie et auteur de l’essai Le syndrome de Calimero dont je vous ai parlé dans notre épisode #223 J’arrête de me plaindre. Dans ses travaux, il distingue 3 types de plaintes :
Le besoin non comblé
Les sources de frustration et d’agacement dans nos quotidiens chargés et nos multiples interactions sociales ne manquent pas. En plus, nos attentes ne font qu’augmenter sous l’influence des visions artificielles de la vie des autres sur les réseaux sociaux. Ou des choix multiples soi-disant possibles qui s’offrent à nous. Bonjour la frustration !
L’habitude, la lamentation ponctuelle
Pour certains, se plaindre est même un art de vivre ou encore un style que nous nous donnons d’être sans cesse débordés, acculés, critiques. Je pousserais même à dire que cela peut devenir une habitude inconsciente, un réflexe. Nous avons tous un ami qui trouve toujours que rien n’est assez bien parce que son esprit critique lui donne une contenance et démontre une forme d’intelligence soit-disant plus pointue que le reste du groupe.
Une forme de haine chronique à l’égard du monde et des autres
Cette forme est beaucoup plus rare.
Et nous avons tous aussi dans nos entourages respectifs un Calimero, du nom de ce petit poussin jaune de dessin animé, qui se plaint de tout et tout le temps.
Se plaindre dans une société de performance
Pourtant, c’est un exercice devenu de plus en plus difficile dans la société du bien-être où devenir la meilleure version de soi-même est érigée en désir universel. Rien ne sert de râler contre les gens agressifs dans le métro, tout est question d’attitude. Sous cette pression, combien sommes-nous à serrer les dents quand nous aurions envie d’exploser ? Je revois encore mon amie me dire quand je ventilais à propos de ma boss ‘Tu ne la changeras pas, travaille ton indifférence, ton lâcher-prise. C’est ton attitude qui n’est pas la bonne.’ Dans ce contexte, nous sommes plutôt poussés à prendre sur nous.
La plainte, une affaire de lien
En fait, la plainte n’existe qu’en relation avec l’autre. Je ne me plains pas à moi-même, ma plainte existe parce que j’ai l’opportunité et l’envie de la déverser sur quelqu’un. Soit je le fais trop et je suis envahissante et exaspérante pour les autres, soit je ne le fais pas assez et alors j’ai le sentiment que les besoins des autres prennent le pas sur les miens. Dans les deux cas, mon besoin d’être réconforté/e ou d’entrer en relation avec l’autre n’est pas comblé.
Pourquoi nous plaignons-nous ?
Robin Kowalski, psychologue américaine, a défini les 5 raisons principales qui motivent les gens à se plaindre :
- Recherche d’attention : se lamenter sur les réveils nocturnes en raison de la gastro-entérite du petit dernier attire l’attention. Les autres me consolent, je me sens important, je me sens faire partie du groupe.
- Dégager ma responsabilité : quand je me plains de mon boss ou de mon conjoint, je déporte la responsabilité de mon mal-être sur eux et je m’exonère de chercher une solution. Ça me dédouane.
- Parfois, pour générer de l’envie. C’est assez insidieux cependant, il peut nous arriver de chercher à mettre indirectement en avant nos qualités. ‘Oh j’ai tellement de travail’ peut sous-entendre que je suis absolument indispensable.
- Chercher des alliés. Se plaindre peut créer une connivence avec les autres. Ce peut être contre quelqu’un par exemple.
- Excuser son manque de performance. En mettant en avant des circonstances atténuantes. ‘Le métro s’est encore arrêté, ce n’est vraiment pas de chance. Sans ça j’aurais été à l’heure en réunion’
De nouveau, nous ressentons combien le but ultime de la plainte est d’entrer en relation avec l’autre ou de renforcer nos liens sur un terreau négatif. Je vais y revenir.
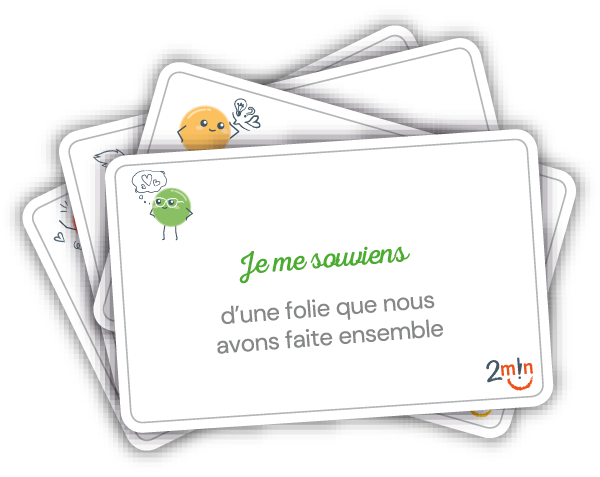
Envie d’un moment d’échange et de complicité à 2 ? D’être entendu par votre chéri(e) dans votre souffrance ?
Le jeu de couple 2 minutes de bonheur® en couple est fait pour vous !
Se plaindre dans une société de performance
Pourtant, c’est un exercice devenu de plus en plus difficile dans la société du bien-être où devenir la meilleure version de soi-même est érigée en désir universel. Rien ne sert de râler contre les gens agressifs dans le métro, tout est question d’attitude. Sous cette pression, combien sommes-nous à serrer les dents quand nous aurions envie d’exploser ? Je revois encore mon amie me dire quand je ventilais à propos de ma boss ‘Tu ne la changeras pas, travaille ton indifférence, ton lâcher-prise. C’est ton attitude qui n’est pas la bonne.’ Dans ce contexte, nous sommes plutôt poussés à prendre sur nous.
La plainte, une affaire de lien
En fait, la plainte n’existe qu’en relation avec l’autre. Je ne me plains pas à moi-même, ma plainte existe parce que j’ai l’opportunité et l’envie de la déverser sur quelqu’un. Soit je le fais trop et je suis envahissante et exaspérante pour les autres, soit je ne le fais pas assez et alors j’ai le sentiment que les besoins des autres prennent le pas sur les miens. Dans les deux cas, mon besoin d’être réconforté/e ou d’entrer en relation avec l’autre n’est pas comblé.
Pourquoi nous plaignons-nous ?
Robin Kowalski, psychologue américaine, a défini les 5 raisons principales qui motivent les gens à se plaindre :
- Recherche d’attention : se lamenter sur les réveils nocturnes en raison de la gastro-entérite du petit dernier attire l’attention. Les autres me consolent, je me sens important, je me sens faire partie du groupe.
- Dégager ma responsabilité : quand je me plains de mon boss ou de mon conjoint, je déporte la responsabilité de mon mal-être sur eux et je m’exonère de chercher une solution. Ça me dédouane.
- Parfois, pour générer de l’envie. C’est assez insidieux cependant, il peut nous arriver de chercher à mettre indirectement en avant nos qualités. ‘Oh j’ai tellement de travail’ peut sous-entendre que je suis absolument indispensable.
- Chercher des alliés. Se plaindre peut créer une connivence avec les autres. Ce peut être contre quelqu’un par exemple.
- Excuser son manque de performance. En mettant en avant des circonstances atténuantes. ‘Le métro s’est encore arrêté, ce n’est vraiment pas de chance. Sans ça j’aurais été à l’heure en réunion’
De nouveau, nous ressentons combien le but ultime de la plainte est d’entrer en relation avec l’autre ou de renforcer nos liens sur un terreau négatif. Je vais y revenir.
Les effets de la plainte sur le cerveau
Le négatif justement parlons-en. Attention, se plaindre nous pousse à nous plaindre toujours plus sous l’effet de la neuroplasticité cérébrale. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes dont le #251 sur les croyances positives.
La neuroplasticité cérébrale, c’est cette capacité de nos cerveaux à continuer à se développer tout au long de notre vie et sous l’influence de nos réactions aux stimuli. Lorsque j’envoie un signal répété à mon cerveau comme une émotion en réaction à un stimulus particulier, je consolide des connexions dans mon cerveau.
Je crée des routes qui vont s’activer beaucoup plus rapidement au fur et à mesure que je leur envoie les mêmes signaux. Ça peut se révéler positif ou négatif car si j’envoie des pensées positives au cerveau, je vais être de plus en plus réceptif au positif autour de moi. A l’inverse, si j’ai renforcé des circuits de frustration, de découragement ou de tristesse, ceux-là aussi risquent de s’activer plus facilement et rapidement quand un signal leur sera envoyé.
Plus je suis positif, plus je le deviens et idem pour le négatif. Si je reviens à la plainte, plus je me lamente, plus je vais reproduire ce comportement à l’avenir et parfois inconsciemment, sous l’influence de mon cerveau que j’ai éduqué à se plaindre.
Rappelez-vous aussi que ce mécanisme est d’autant plus fort que notre cerveau a été éduqué pour faire face aux menaces. Il est donc naturellement plus réceptif aux signaux stressants qu’aux stimuli positifs qui peuplent notre environnement. Je vous en ai parlé dans notre épisode #128 sur les mécanismes primaires du cerveau.
Se plaindre sur le long terme
Sur le long terme, se plaindre de façon chronique peut bouleverser le fonctionnement standard de notre cerveau générant des impacts significatifs sur notre santé. Se plaindre conduit à développer de l’anxiété, du stress qui déclenche la libération du cortisol dans notre corps.
Rappelez-vous cette chimie expliquée dans notre Bulle de Bonheur #120 sur le stress. Le cortisol a ses vertus, il met en sommeil certaines fonctions non essentielles de l’organisme pour concentrer toutes nos ressources vers la gestion de la menace. L’enjeu est lorsque notre organisme reçoit trop de cortisol. Dans ce cas, certaines études ont démontré que le cerveau peut être affecté durablement. Des fonctions comme la capacité à résoudre des problèmes complexes, la prise de décision ou encore la planification peuvent être durablement affectées.
Sur le plan du bien-être, la rumination rend pessimiste et bloque le champ des possibles. Cela nous rend moins adaptables et moins résilients devant les obstacles – Je vous renvoie à notre Bulle de Bonheur #83 sur la rumination.
Enfin, dernier danger et pas des moindres, par le jeu des neurones miroirs, en râlant continuellement, je cours le risque de contaminer mon entourage.
Se plaindre… et nos relations
D’ailleurs, et nos relations dans tout ça ?
Je vous retourne la question. Nous connaissons tous un Caliméro dans notre entourage. Est-ce que vous appréciez sa compagnie ? Est-ce que vous la recherchez ? Je vais deviner que dans la majorité des cas, c’est plutôt non ou alors à petite dose. Parce que oui, se plaindre de façon intempestive et très fréquente nuit à nos relations.
Les effets positifs de se plaindre
Alors maintenant, je vais vous choquer un peu… Saviez-vous que les râleurs sont plus susceptibles de se réaliser dans la vie et d’atteindre un meilleur niveau de bien-être durable ? C’est ce que confirme une étude de 2024 menée sur 2600 ados de 14 ans. Pourquoi ?
D’abord, se plaindre permet de soulager les sentiments négatifs. Sur ce point, je veux revenir au début de cet épisode pour un court aparté sur la positivité toxique. La positive attitude s’est un peu érigée en une forme de philosophie du développement personnel et je ne voudrais pas m’en faire le relais ici. La positivité toxique est un excès qui voudrait que nous ayons tous en nous les capacités d’être optimistes et heureux de vivre en tout temps et dans toutes les circonstances.
Dans ce contexte, le bien-être devient une obligation et si nous ne l’atteignons pas, alors c’est que nous sommes la source du problème. La positivité toxique est donc culpabilisante et renforce des schémas négatifs de dénigrement, de manque de confiance en soi et de comparaison. Se plaindre c’est ok, reconnaître ce qui nous chicotte dans notre environnement, c’est ok. Ce n’est pas une marque de faiblesse, c’est aussi juste la vie. Je veux donc considérer la plainte comme une alternative au fait de prendre toujours plus sur nous, de serrer les dents et les fesses coûte que coûte.

Prenez le temps d’être heureux et inscrivez-vous à notre newsletter #lapétillante et recevez un bon de 5% de réduction sur toute notre boutique
Les bienfaits inattendus de la plainte
Se plaindre permet de prendre du recul
Changeons de regard : Robin Kowalski s’est concentrée sur les bénéfices de verbaliser nos sujets d’insatisfaction ou de frustration. Elle distingue 2 types de plaintes salutaires :
- Expressive, qui permet juste de ventiler, d’évacuer l’émotion négative et son déclencheur en levant le couvercle et en laissant littéralement sortir de nous ce qui nous agace.
- Instrumentale, qui permet de se mettre en action pour atteindre un objectif, dépasser un obstacle.
Dans les deux cas, se plaindre a la vertu de nous permettre de faire un pas de côté pour prendre du recul sur une situation dérangeante et de poser des mots sur notre ressenti. Cela nous permet aussi de relâcher la pression de la cocotte-minute et d’éviter d’exploser ou d’imploser.
Créer du sens grâce à la verbalisation de la plainte
Comme je le mentionnais en introduction, par nature, se plaindre suppose une relation, d’avoir un auditoire pour partager ce qui nous traverse. Or, pour ce faire, nous avons à trouver et poser des mots sur ce qui se passe en nous. Cela peut représenter un effort. Pourtant, souvent, le fait de verbaliser crée de la fluidité, de la clarté. Le simple fait d’extérioriser remet de l’ordre dans nos ressentis et l’objet de nos lamentations. Mettre des mots est un vecteur de sens qui nous aide à voir plus clair. C’est un bienfait comparable à ceux de l’écriture dont je vous ai parlés dans notre épisode #156.
La connexion aux autres
Qui dit auditoire dit connexion aux autres. Alors que nous parlions des méfaits de la plainte excessive sur l’entourage et le lien aux autres, il semble que se plaindre de façon raisonnée et raisonnable renforce au contraire nos relations.
Ce peut être dans la petite plainte de tous les jours. Vous aussi vous avez déjà connecté d’un regard quelqu’un lorsque vous attendez semi patiemment au guichet de la Poste.
Ce peut être aussi en co-ruminant franchement avec nos pairs. Une étude a été menée par des psychologues de l’université Simon Fraser et de l’université du Sussex. Ils ont interrogé 2500 participants et découvert que discuter de nos sources d’agacement impacte positivement notre bien-être.
Nous ne parlons pas ici de partager des récriminations excessives et continues. Les chercheurs différencient la ‘discussion de soutien’ des ‘pleurnicheries obsessionnelles’. Dans le premier cas, l’autre est une oreille attentive et constructive qui nous permet de mieux nous comprendre et de progresser vers la résolution du problème. Par exemple, je culpabilise souvent après avoir ventilé auprès de ma collègue sur ma manager et ses défauts qui me bouffent la vie certains jours. Pourtant, je dois reconnaitre qu’après lui avoir parlé, je me sens plus patiente, plus capable de passer au travers de 10 000 sollicitations désorganisées de ma boss.
Par ailleurs, mon estime de moi est renforcée car je sens que je compte, que je suis importante aux yeux de ma collègue qui m’a écoutée. Je me sens validée. Mon besoin fondamental d’appartenance identifié par la théorie de l’autodétermination – je vous renvoie à notre épisode #221 – est nourri. Cela me garde confiante et motivée, je suis plus résiliente. La discussion de soutien, même sur fond de plainte, est donc positive pour notre bien-être lorsqu’elle s’appuie ou donne naissance à des vraies amitiés sincères et constructives.
Le discernement, bénéfice secondaire de la plainte
Enfin, râler peut-être constructif. Lorsque nous en faisons quelque chose, comme par exemple un instrument de discernement. Discernement pour comprendre ce qui se passe pour nous et identifier la source de notre plainte. Se plaindre peut déclencher une prise de conscience et nous permettre de mettre le doigt sur un besoin non satisfait, un désir de changement. De là à passer à l’action, il n’y a plus qu’un pas !
Les 5 critères de la plainte constructive selon Tomasella
Je reviens à Saverio Tomasella dont je vous parlais en début d’épisode. Comment faire pour se plaindre sans tomber dans le piège de la rumination qui enferme notre cerveau dans des schémas négatifs ? Saverio Tomasella observe qu’il y a 5 critères qui permettent de qualifier une plainte constructive :
- Elle doit être honnête et rester factuelle
- Respectueuse ; ne pas constituer une attaque dirigée contre quelqu’un
- Constructive ; que puis-je apporter comme piste de solution ?
- Facilitatrice ; elle doit permettre de sortir du conflit, de l’obstacle dans lequel nous nous sentons englués
- Assertive – Rappelez-vous, c’est une belle attitude dont je vous ai parlé dans notre épisode #256. L’assertivité permet un juste équilibre entre le respect de soi et des autres. C’est ce qui nous permet de sortir d’une situation potentiellement conflictuelle sans mettre à mal sa relation à l’autre.
Cette approche repose sur quelques prérequis :
Être doux et bienveillant
Avant tout, j’aimerais revenir sur le sujet de la positivité toxique et vous inviter à être doux et bienveillant avec vous-mêmes. Trop souvent, nous décuplons les effets négatifs de la plainte en nous accusant d’être trop nuls de nous plaindre, en culpabilisant de le faire, en nous sentant faibles. Souvent, notre discours intérieur avec nous-mêmes est bien plus dur que le traitement que nous adoptons avec les autres. Je vous recommande de réécouter notre épisode #137 sur la bienveillance pour réfléchir à votre petit démon intérieur qui parfois vous disqualifie.
Reconnaitre ses émotions
Puis, je vous recommande d’apprendre à reconnaître et parler de vos émotions. Cela exige une vraie attention à soi et des compétences dont je vous ai parlé dans notre épisode #140. Les émotions sont nos alliées, vous le savez chez Bulle de bonheur, nous louons souvent leur pouvoir de nous faire prendre conscience, souvent par le biais du corps, de ce qui se passe dans notre esprit ou notre cœur.
Se montrer vulnérable
Communiquer nos émotions aux autres et être capable d’adopter une posture constructive repose sur le fait de se montrer vulnérable. C’est accepter d’ouvrir le kimono et dire comment on se sent. Et l’exercice est loin d’être facile. Dans certains contextes, que ce soit professionnel ou personnel, cela peut se révéler un beau défi. Se plaindre c’est aussi oser se plaindre, se reconnaître avec ses limites et accepter de se laisser voir ainsi en faisant tomber le masque. Je vous invite à faire un détour par notre Bulle de Bonheur #49 sur la vulnérabilité pour creuser cette piste.
Se plaindre avec les bonnes personnes
Enfin, se plaindre, oui. Cependant, avec les bonnes personnes ! Râler auprès d’un inconnu est certainement libérateur. Cependant, vous en retirerez plus de bienfaits lorsque vous vous ouvrez à des gens que vous estimez. Car ce sont eux dont l’opinion et la validation sont importantes à vos yeux. Co-ruminer est une stratégie gagnante avec des gens qui comptent pour vous.
En résumé, se plaindre…
- Soulage la répression émotionnelle.
- Peut augmenter la résilience
- Commence par une attitude assertive et bienveillante envers soi-même.
A vous de jouer chers auditeurs, cette semaine, il y a de fortes chances que vous râliez ; la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de bien choisir auprès de qui et d’observer combien cela transforme votre expérience.
Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d’être heureux !
La Petite Mousse de 2 minutes de Bonheur
« La conversation de deux amis rend leurs biens et leurs maux communs. Elle augmente leur plaisir et diminue leurs peines. Rien ne soulage tant la douleur que la liberté de se plaindre. »



